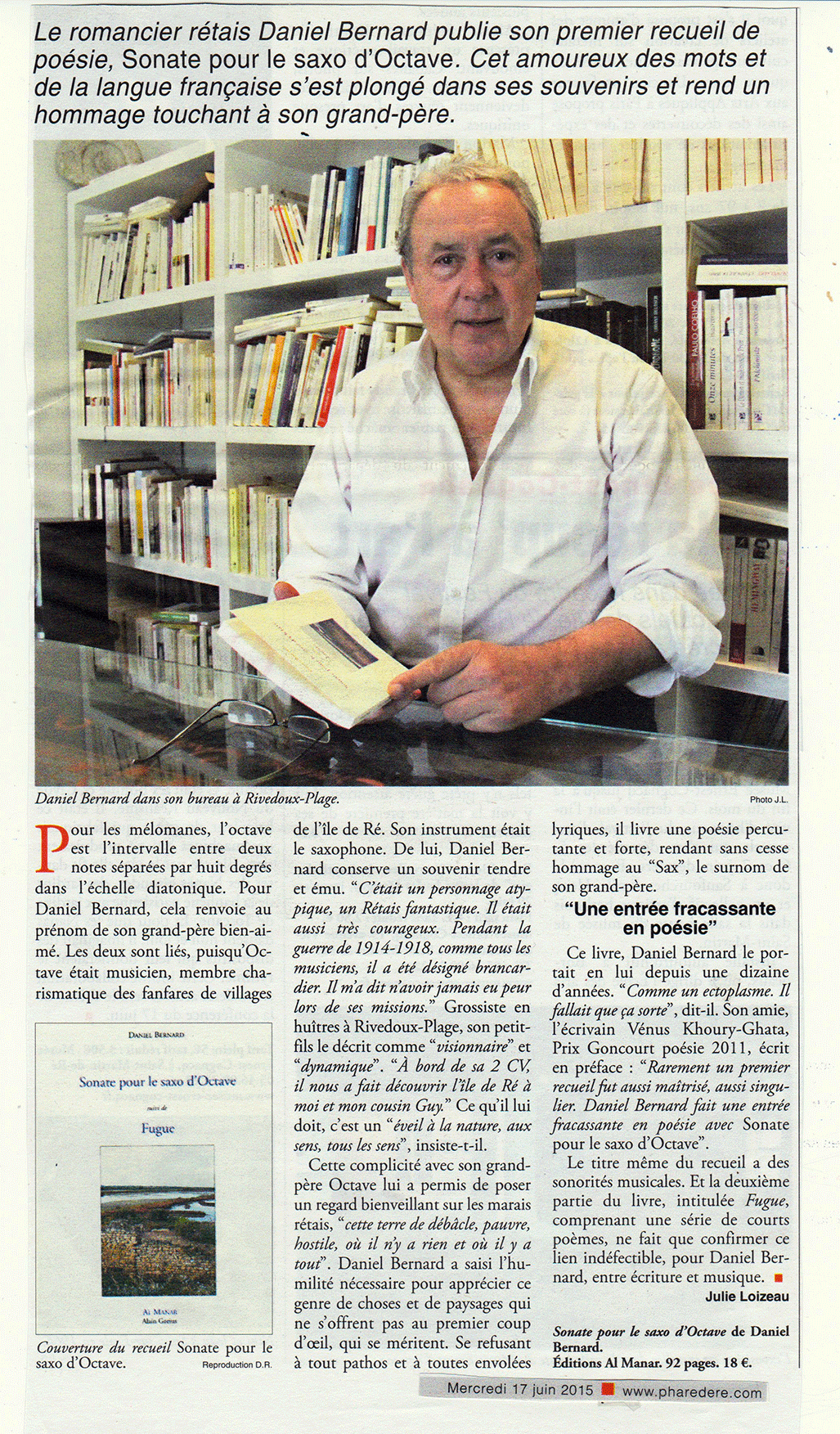Description
C’est d’abord une balade au grand air à laquelle l’auteur nous convie, une ballade musicale à travers le marais du Fier d’Ars sillonné par le passage du temps et le chemin creux du bonheur, si creux qu’on ne peut le prendre seul.
Dès l’incipit, on note qu’il n’y a pas de verbe comme si la nudité du lieu imposait d’emblée le dépouillement du texte.
La platitude comme une rouille
La digue comme accoudoir au silence
Au fil des mots, on voit les sauniers travailler, vivre, rire, mourir au rythme des saisons et tenter de se jouer du temps qui les dérobe à eux-mêmes.
Telle une vague de henné dans la rumeur de l’aube l’horloge des marées cernait les ailes du temps,
cabossés par la pluie des fenouils nous avancions dans ce vaste reposoir salant où des sauniers va-nu-pieds mendiants d’amour riaient devant d’infortunés tombeaux de sel où à chacune de leurs pelletés venait s’écraser la semence d’un été mort d’avoir trop aimé.
Avec la flamboyance de l’automne, le marais devient cet «ailleurs rêvé», en référence à Rimbaud. Dans cette « réalité rugueuse » : Un bel endroit pour devenir assassin, l’auteur constate que le pire côtoie le meilleur et la beauté, la laideur.
À l’heure où sous la houle d’un ciel fauve l’automne étale sa rousseur et sa robe de feu
dans le marais on éventre la glaise pour mieux tracer des sillons dans la mer
on tue le temps suspendu à l’ombre des lanternes
on étouffe les cris enterrés vivants dans le trou noir de l’océan et que les vagues déterrent
Un bel endroit pour devenir assassin. On ne sort jamais indemne d’une morte saison
Le poète, sous les mots d’Octave, nous engage à renouer avec le «vrai pays», le lieu des vérités essentielles, et à venir écouter la nature, cette mer sans âge qui vient s’échouer dans les fenouils pour apprendre aux ânes comment être au monde puisque les hommes en sont absents.
Il vous faudra renouer avec le solstice d’été croire au désert humide
au partage des eaux entre mer et clocher
Là où la vague des fenouils s’érige en colline
la mer vient s’asseoir pour apprendre aux ânes à se souvenir
La poésie devient soulèvement de la parole devant un monde devenu fou. Le héros excédé finit par brandir la vaine et dérisoire colère des sans-grade.
Vous n’avez pas idée de cette terre qui saigne
ni de la colère des papillons
« Ces textes sont d’une beauté à scier le cœur. Le personnage principal n’est autre que le saxo du grand-père Octave qui soumettait les notes et les femmes à la peau brune. Ces paysannes de la mer, ces filles des marais jetaient trois pincées de sel par-dessus leur épaule avant de refermer leurs jambes buissonnières sur le saxophoniste. Mais les larmes de jouissance de ces femmes resteront toujours un mystère pour le musicien.
Rarement un premier recueil fut aussi maîtrisé, aussi singulier. Daniel BERNARD fait une entrée fracassante en poésie avec Sonate pour le saxo d’Octave ».
Vénus Khoury-Ghata
Prix Goncourt poésie 2011
Une histoire de famille et d’amours
Daniel Bernard nous dévoile la vie des sauniers et celle de son grand-père Octave avec qui il parcourait plus jeune les marais et que l’on surnommait « Le Sax ». L’insouciance de sa jeunesse, le lamento d’une seule note de son saxo, Lydia appelée « La Douce », puis la guerre qui change la donne et le temps qui passe, transformant les hommes comme les paysages.
Les liens de filiation, d’amour et d’amitié sont les racines de cette histoire. Les sentiments sont décrits, déployés, au fils des pages et des mots, nous laissant entrevoir sensualité et érotisme. Des liens tissés par un grand-père admiré de sa descendance :
« Reconstruire le grand-père le façonner de glaise, d’océan et d’oiseaux l’habiller de vent pour mieux le ranimer deux gouttes d’eau fossiles en place de ses yeux bleus devenus pierres à force de ne plus voir et un écrin de brume pour sortir son âme en crue aussi fraîche que rosée et coeur de camélia »
La symphonie des sens au service d’un voyage immobile
Chaque page de « Sonate pour le saxo d’Octave » mobilise un sens nouveau : la vue avec la description de nombreux paysages, des bords de l’océan aux marais salants. Des paysages, qui selon la lumière, nous font passer de l’angoisse à la plénitude. Des lieux qui s’amoncellent dans notre esprit comme des tableaux.
L’ouïe ensuite, avec le bruissement des herbes folles, le murmure des vagues, le grondement de la mer au loin et surtout la profondeur de la musique du saxophone d’Octave.
Et enfin, la simplicité du goût et du toucher, pour nous décrire les amours d’Octave et pour nous parler des caresses du vent salé. Des mots tendres et sensuels, précis et remarquables, pour nous faire revivre le contenu de ce recueil et nous transporter au plus près du « Sax. »
« Une lune au teint de craie ébréchée comme un bol avançait à grandes enjambées peignant les baisers du Sax comme perles de collier avec des crayons de couleur L’horloge des marées cernait les ailes du temps de peinture verte comme celles du moulin du saunier. »
Une Ode à la nature et à la beauté d’une région
Le Fier d’Ars, l’océan, Lilleau des Niges, les marais, les digues, les pierres, les sauniers, le sel… L’île de Ré est au coeur de chaque page, au coeur de chaque mot. Daniel Bernard nous parle d’une nature belle et capricieuse, des marais chers aux habitants de l’Ile et que les touristes méconnaissent.
Une célébration des éléments devant laquelle toute personne se sent partagée entre impuissance et admiration. L’auteur nous dévoile les paysages de son enfance, les lieux écorchés par l’homme, la violence des intempéries et aussi la tempête Xynthia. « Sonate pour le saxo d’Octave » souligne que la nature comme les êtres, la vie comme les sentiments peuvent être animés par la fureur de l’océan. « Sonate pour le saxo d’Octave » souligne que la nature comme la vie, les corps et les sentiments peuvent être abîmés par le temps qui passe.
« Fils d’une île aux rives desséchées entraînés au loin dans l’impatience du soleil il vous faudra chercher sommait le Sax là où la vague des fenouils s’érige en colline là où chaque quinzaine un marais perdu se pend à la grande aiguille de l’horloge des marées
Il vous faudra renouer avec le solstice d’été croire au désert humide au partage des eaux entre mer et clocher »
Comme le conclut Vénus Khoury Ghata, prix Goncourt poésie 2011, dans la préface de « Sonate pour le saxo d’Octave », ce sont des textes-offrande au grand-père musicien.
Des mots qui sonnent, qui transportent, qui éclairent et résonnent. Un recueil à lire comme une invitation au « voyage immobile » et à contempler la fureur du paysage.

Les marais et la digue qui les protège sont souvent présents dans vos textes.
À quelle époque situez-vous votre première escapade dans le Fier d’Ars ?
Cela s’est passé, je crois, l’année de mes quinze ans. J’allais au lycée. C’est à ma prof de français, qui avait une sainte horreur des coquillages, je l’ai appris plus tard, que je devais le choix de l’exposé qui m’était échu. Il s’agissait de parler de la culture des huitres dans les anciens marais salants. Activité dont, à l’époque, je ne percevais ni la finalité ni le sens. Je n’avais par ailleurs qu’une vague idée de l’endroit où cela se passait. Dans mon esprit, j’imaginais un lieu secret, bourbeux et retiré du monde, plein de vent, de rumeurs d’oiseaux et où l’horizon tient l’océan à distance.
Je suis entré avec curiosité dans le marais, par une froide matinée de décembre, un jour ordinaire. Nous marchions, mon cousin et moi, derrière notre grand-père Octave, à grandes enjambées dans les herbes séchées, frigorifiés malgré nos anoraks et pantalons doublés. De part et d’autre du chemin, une écume légère comme une aile immobile flottait sur un immense miroir atone et vide. Le soleil n’arrivait pas à dissiper la brume qui pétrifiait le silence dans un manteau de glaise. C’était étrange, l’envie de revenir sur mes pas m’étreignait et en même temps, la résonance du lieu m’invitait à me perdre. J’étais en errance. Un endroit véritablement à sombrer ou à défier le ciel. Se pouvait-il que ce pâle rivage ne fût qu’un embarcadère vers le rêve ? Je sentais naître en moi des sensations confuses, malhabiles, écartelées comme des voiles face à des vents contraires. Ces déroutants désordres n’étaient pas sans me rappeler certains regards de femmes dans la rue qui m’éperonnaient en silence. À part Verlaine, dans l’insomnie de son vieux parc solitaire et glacé, personne ne m’avait jamais interpelé de la sorte. Je n’en suis toujours pas revenu.
Les années passant, l’initiation réduite à l’épaisseur d’un duvet de cygne me ramenait sans cesse à l’enfance, au temps où les tessons de soleil trouaient mes poches, où le vol simple d’un papillon éclairait l’instant et me tenait en équilibre sur la tranche d’un brin d’herbe.
Aujourd’hui je cherche un alibi, un bon, ou une mauvaise excuse pour m’échapper du monde, me la couler douce. Je ne trouve que des salicornes enchâssées dans l’eau dormante dont la principale occupation est de glisser sur le temps avec des caprices de nénuphars, et la digue comme un arc tendu vers l’océan. Je sais que ce mur n’est plus exactement le havre des navires qui venaient chercher le sel. L’enceinte de pierres sert d’accoudoir au silence. Enceinte ! Ce mot soudain la rend féminine. Il suffirait de considérer l’angle où le béton prend visage pour admirer la douceur de ses traits. Il suffirait d’assiéger ses courbes orgueilleuses pour prendre l’océan de haut, de croire que la légère excroissance de son arrondi n’est que le résultat d’un déhanché suggestif. Il suffirait d’imaginer l’élégante sous les assauts de l’océan, la voir plonger dans le ressac et puis en sortir, les algues au ras des flots, pour espérer déshabiller sa pudeur. Il suffirait.