Description
La critique
| « L’anneau » par Albert Bensoussan
Nous connaissons l’Albert Bensoussan traducteur du meilleur de la littérature latino-américaine, ce voyageur infatigable à la découverte de ces chemins traversant le monde et les hommes. Si loin ou si proches lorsque nous prenons comme mesure la distance euclidienne, mais si semblables quand nous nous référons à ce que nous partageons tous, les couleurs de l’enfance, les émotions et les amours volés comme, malheureusement, les déchirements de mémoire et les séparations au fil du temps. Ceux qui ont eu la chance de l’entendre savent aussi ses talents de conteur où, d’une idée à l’autre, d’une anecdote à une autre, les personnages se rencontrent incidemment, des filiations inattendues se créent, des situations cocasses se construisent, autant de souvenirs ténus et d’images fortes qui les empreignent. Jean-Louis Coatrieux |
 |
Hymne à l’Algérie heureuse
…
Albert Bensoussan, « L’anneau », éditions Al Manar, 115 pages, 20€
Toute douleur est un mal d’exil
La quatrième de couverture éclaircit parfaitement le titre et le propos du livre : « L’anneau merveilleux, […] c’est le kholkhal que portait la mère au temps où juifs et musulmans vivaient séparés, mais ensemble dans cette Algérie qui a disparu » et dont le souvenir va si profondément ensuite marquer la vie et l’œuvre d’Albert Bensoussan, installé aujourd’hui à Rennes où il vit et enseigne à l’université depuis 1963.
Albert Bensoussan, L’anneau. Al Manar, 116 p., 20 €
Sa propre mère, tout imbibée qu’elle fût, à l’origine, d’un mélange spécifique de culture hébraïque et de croyances populaires locales, se verra elle aussi amenée à se réfugier en France sous la pression des événements, non sans ressentir une poignante mélancolie. En un certain sens, l’œuvre littéraire d’Albert Bensoussan, écrite en un milieu entièrement distinct de l’espace premier, sera une façon de le retrouver par l’émotion que fait renaître la plume, et qui vibre avec une intensité singulière, fût-ce sous un tout autre climat.
Voilà sans doute pourquoi cette nostalgie initiale imprègne, par toutes sortes de retournements imaginaires, la mémoire et les récits d’Albert Bensoussan, qui sont si souvent marqués par l’heureuse surprise d’impossibles retours ou de paradoxales rêveries. Alors qu’il sait pertinemment que sa mère « repose sous la dalle au cimetière de Pantin », il se plaît à l’imaginer enfant, comme une petite fille qu’il aurait élevée lui-même, « heureuse d’aller à l’école et de maîtriser, enfin, la langue française ». Pour échapper à son désastre intime, il inverse ainsi les rôles. Bien entendu, cette pseudo-dénégation est une de ces pirouettes dont il est friand et qui lui font mieux supporter la douleur ou les imprévus du destin.

Il y a aussi – mais tout de même un peu au second plan – un père qui se voit propulsé dans la métropole par la guerre de 14-18, et dont le retour, après une grave blessure, marque justement la naissance du futur écrivain, en une sorte de victoire personnelle : « Je suis né de ce défi », affirme-t-il. Mais de nouvelles complications ne manqueront pas de surgir avec la Seconde Guerre mondiale et le souci du gouvernement de Vichy de répandre ses lois antisémites jusque sur l’autre rive de la Méditerranée. Le portrait du Maréchal était punaisé dans toutes les classes des écoles, se souvient Bensoussan. Certes, le soudain débarquement des Alliés mettra fin à tout cela mais, par la suite, comme on le sait, ce sont tous les citoyens français qui deviendront indésirables, même s’ils étaient bien loin de tirer quelque profit colonial pour nombre d’entre eux.
Bref, l’Indépendance supposera le départ de tous, riches ou non. « C’est vrai, j’ai fui l’Algérie il y a un demi-siècle », observe Albert Bensoussan, que son nom de famille ne suffisait nullement à protéger comme on pourrait le croire naïvement. Une mélancolie l’assaille en songeant à ce qui fut et à ce qui aurait pu être. Un « rêve récurrent » manifeste une nostalgie : « Nous avons appris ensemble le baiser, Fatiha ». Mais, décidément, de l’Algérie qui fut, toutes les traces sont systématiquement promises à l’oubli.
L’anneau d’Albert Bensoussan
Par Norbert Bel Ange le 14 mai 2017, dans « Morial », Mémoire et traditions des juifs d’Algérie
Dans le formidable aréopage des « Albert » célèbres, je me plais à citer Albert Einstein et sa langue bien pendue, Albert Cohen son fume-cigarette, sa calvitie débonnaire et sa robe de chambre légendaire.
Albert Camus de Belcourt en Alger…
Et voici que s’avance un autre Albert, Albert Bensoussan, un Algérois lui aussi mais de Bab el Oued. Ou de pas loin. Un tout jeune homme ! Un jeunot ! Même s’il court sur ses… Mais jouons les coquettes et taisons son âge.
Nous avons mieux affaire avec son œuvre. Œuvre prolifique s’il en est. Albert Bensoussan a publié au bas mot une trentaine d’ouvrages, dont certains figurent en bonne place dans ma bibliothèque.
Juste une incise avant que de revenir à son œuvre fictionnelle et récitative.
Albert Bensoussan est un grand traducteur de l’espagnol vers le français Entre autres des romans de Vargas Llosa. Professeur de littérature espagnole et hispanique en ses universités bretonnes (Rennes), il est en cela le digne successeur d’un certain André Belamich, traducteur de Federico Garcia Llorca, à la demande d’Albert Camus !
Mais André Bélamiche que j’ai eu l’occasion de rencontrer, chez lui, à Villeneuve-sur-Mer, est un Oranais bon teint.
Vous me suivez…André l’Oranais et Albert l’Algérois !
Mais soyons sérieux et tirons un peu la couverture à soi, c’est-à-dire vers l’ouest algérien, vers Remchi ou Montagnac, c’est selon.
Ce sont là les terres familiales des Bensoussan. Et, dans son dernier opus, « L’anneau » (éditions Al Manar, 2017), Albert Bensoussan, évoque d’abondance cette cité maghrébine.
Une remarque littéraire avant que de poursuivre. Au fil de son œuvre, Albert Bensoussan est devenu le chantre extraordinaire de ce judaïsme algérien qu’il connaît bien. Les spécialistes de cette littérature citent souvent son œuvre. Les historiens se devront de s’y référer. Et l’on se demandera mais qu’a écrit Albert Bensoussan à ce sujet… Comme nous disons toujours : « Mais que nous dit Rachi de Troyes sur tel ou tel passage de la Thora ? »
En un peu plus de cent pages, Albert Bensouusan évoque ses mémoires familiales. Son texte balance entre récit et autobiographie sans oublier en chemin la grande Histoire. Je songe ici à sa mémoire familiale de la Grande Guerre pour laquelle nous manquons cruellement de récits, de journaux, de lettres… J’y reviendrai dans un travail plus personnel consacré à la Grande Guerre.
Le père d’Albert Bensoussan fut l’un des Poilus juifs d’Algérie, les plus décorés de la Grande Guerre. Ce soldat de 14 fut par la suite un officier d’active, chose rare dans le judaïsme algérien.
Si « L’anneau » évoque le cycle de la vie, il évoque aussi les Khalkhal dont nos grands-mères ornaient leurs chevilles.
Dans ces pages de beau papier, Albert Bensoussan ne cesse de nous livrer recettes de cuisines, senteurs, odeurs épicées de nos enfances enfuies…
Comment ne pas penser en lisant Albert Bensoussan au bel essai de Joëlle Bahloul « Le culte de la table dressée » !
À vous lire cher Albert, me vient l’envie de savoir comment vous travaillez, comment vous viennent tous ces récits ?
J’ai cru comprendre que dès votre jeune âge vous avez beaucoup écouté vos parents, beaucoup noté sur vos petits cahiers. Et que vous y puisez allégrement comme dans le garde-manger grillagé de nos enfances.
J’ai cru comprendre dans ces récits, combien les femmes ont compté et comptent dans votre vie.
C’est la première fois, me semble-t-il, où « vos femmes » sont si présentes dans vos confessions !
À commencer par votre maman. Vous la revoyez dans ses montagnes dans la compagnie des femmes musulmanes au moment de la tonte des moutons !
Page 13, vous écrivez au sujet de votre maman :
« Oui c’est moi qui t’aurais élevée, et tu aurais été heureuse d’aller à l’école en me donnant la main, et de maîtriser enfin la langue française ».
Ne vous en déplaise cher Albert Bensoussan, il y a chez vous du Albert Cohen ! De « sa tendresse de pitié »!
Qu’il s’agisse de Suzanne, de Fatiha ou de Déborah, c’est avec un bonheur et une belle sensualité qu’elles viennent au-devant de nous. Ou de vos échanges avec André Nahum (zil)
Au sujet de Déborah (p.92)
« Et moi, livré encore à mes songes, dans cette chambre du silence où Deborah bien avant moi, a plongé en sommeil.
Que ma femme est belle, c’est un bébé dormant ! Elle a ramené un pan du drap sur sa bouche et le suçote lentement en poursuivant, si loin, si près, les sombres coursiers de ses chimères. »
Cette sensualité, cette gourmandise se retrouve dans votre goût pour les mots : l’arabe, le français, l’espagnol, le chleuh et l’hébreu se complètent admirablement. Le linguiste que vous êtes en fait son miel.
Lorsque vous parlez du « motsé » distribué vous employez le mot de miochée, emprunté au patois normand, semble-t-il, gourmandise du mot et de la chose !
Il y a quelque chose qui me chiffonne ou alors ai-je mal compris : vous faites d’un fer à cheval un instrument de travail…
Dans mon village, à Fornaka, j’ai pu voir travailler le forgeron, le voir façonner le fer à cheval. Mais pas comme un instrument à moins de le transformer en arme blanche !
Page 58, J’ai trouvé que votre description des hauteurs d’Alger a des accents camusiens. Une fois de plus je relirai « Les noces » et « L’été » grâce à vous.
Pour terminer, je voudrais citer quelques-uns de vos titres publiés aux éditions Al Manar (la tour de feu en arabe, je crois) :
« Aldjazar », « mes Algériennes », « Belles et beaux »…
Sans contredit, cher Albert Bensoussan, vous naviguez avec bonheur et aisance entre récit, poésie, confession et autobiographie, pour nous livrer une partie de vous et de nous-mêmes.
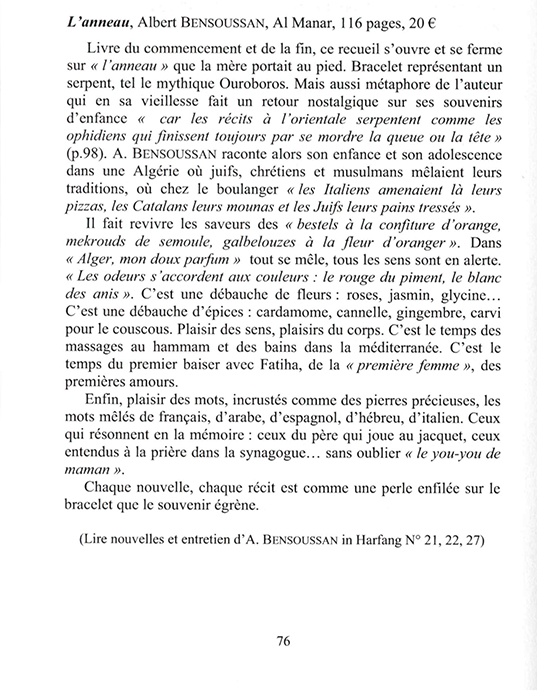
Joël Glaziou, Harfang n° 50, mai 2017
« L’ANNEAU » DE ALBERT BENSOUSSAN CHEZ AL MANAR
26 mai 2017
L’ANNEAU OU LE PARADIS PERDU D’ALBERT BENSOUSSAN
Dans son récit L’Anneau, Albert Bensoussan nous donne les clés de son enfance, dans une langue somptueuse qui mêle saveurs, couleurs et odeurs d’un pays, l’Algérie, et d’une ville, Alger la blanche, à jamais paradis perdus.
Éblouissant.
« L’Algérie au cœur ». Tel pourrait être le titre générique des écrits autobiographiques de cet universitaire rennais et « voix traduisante » de nombre des plus grands romanciers hispanophones contemporains, dont Mario Vargas Llosa, son ami de plus de quarante ans, nobélisé en 2010. Et comme ces autres textes parus précédemment chez le même éditeur, Aldjézar, Mes algériennes, ou Dans la véranda, le récit d’Albert Bensoussan, l’Anneau, publié en janvier 2017 par les éditions Al Manar, ressuscite la prime enfance et jeunesse de l’auteur en Algérie. Tous ces récits sont repris à l’infini, comme en boucle, à l’image du « kholkal », cet anneau de pied qui tintait et brillait à la cheville de la maman de l’auteur, fait d’un cuivre précieux comme l’or dans la mémoire enchantée de l’enfant.
Notre écrivain parcourt ce territoire et cette ville où il est né et a passé ses 26 premières années de vie (26, chiffre divin dans le Talmud…). Comme « l’arbre n’est rien hors d’une terre natale » (Yves Prié), Albert Bensoussan puise sa force dans le terreau de cette Algérie racinaire et nous livre un récit tourbillonnant et « kaléidoscopique » dans lequel vont renaître et s’entremêler les êtres qui l’ont construit : le père, Samuel, héros de la Somme, blessé par un obus en 1915, « si digne, si beau, si reître sur son haut cheval blanc », soigné pendant trois ans à l’hôpital militaire de Rennes par des infirmières dont il gardera à jamais un tendre souvenir, Aïcha, la fiancée, qui l’attendra sept longues années (sept, comme plus tard, le nombre de leurs enfants) et le retour à la paix pour l’épouser, Lalla Sultana, la grand-mère qui ne parlait que l’arabe dans les collines de Tlemcen, « la perle du Maghreb », son époux Messaoud, touchant vendeur d’épices, qui fermait sa boutique pour parler plus tranquillement avec ses clients, Alfred, filleul de Messaoud, qui précéda d’une année au tombeau Aïcha, la maman nonagénaire qui l’adorait plus que tous ses autres enfants et n’en sut jamais rien, protégée par le silence de la fratrie des frères et sœurs d’Albert.
 Aïcha Bensoussan, la maman d’Albert
Aïcha Bensoussan, la maman d’AlbertAïcha est la figure centrale et tutélaire de cette vaste famille – un « dédale cousinal » écrit Albert Bensoussan -, l’alpha et l’oméga de la mémoire de l’écrivain sur laquelle s’ouvre et se referme – l’anneau, toujours…- ce récit matriciel. Les femmes, de toutes les générations, de toutes les expressions, juives, arabes, berbères, qui composaient alors la « vivifiante Algérie », dominent les récits d’Albert Bensoussan. Depuis l’enfance et les premières amours adolescentes, réelles ou fantasmées, dont Fatiha, la « mora », la jeune mauresque « aux yeux gris et célestes » qui enflamme la mémoire d’Albert avec les accents du Cantique des Cantiques : « Je t’aimais pour ton teint de figue sombre et ta pulpe de fève. Tu n’avais pas l’odeur des miens, de mes sœurs, un miel d’aloès jaillissait de tes seins. L’agave peuplait ton aisselle. L’âcre musc de tes reins me soulevait d’ardeur ». Plus tard, beaucoup plus tard, Albert rencontrera Matilda Tubau, femme magnifique et solaire, venue de Catalogne, qui devint son épouse, pour un long temps, jusqu’à sa mort, en 2012 : « Matilda, comment l’oublier ! ». Déborah, son soutien dans le deuil, devint la seconde femme essentielle de sa vie.
Cette enchanteresse et enivrante poésie du verbe, ce carrefour des mots et des cultures qui parcourent sans cesse le récit de cette Algérie « d‘avant », éclairent aussi la mémoire d’une ville qu’Albert Bensoussan nous dépeint à la manière d’un peintre fauve. Alger était alors palette de senteurs, de teintes et de goûts : « À ses odeurs s’accordaient les couleurs, le rouge du piment, le blanc des anis, le vert des absinthes, le gris du poivre, les roses plus vives qu’aux jardins babyloniens, les jasmins si délicats qu’on les glissait aux narines ». Des couleurs et des odeurs exacerbées au marché Randon ou de Chartres, dans le cœur grouillant et bruyant de la ville, où s’offraient en abondance le pain tressé des juifs, les semouleux mekrouds des arabes, comme les zlabiyas dégoulinant de miel ou les galbelouzes à la fleur d’oranger, tous ces mets, tous ces mots, goulûment roulés dans la bouche.
Après novembre 1954 et « le meurtre primordial d’un couple d’instituteurs dans les Aurès, […] le rideau tombe sur l’Algérie heureuse». Les navires rapatrieront, en 1962, les familles de pieds-noirs, qui ne furent pas toutes bien accueillies dans cette France, « mère des arts », chantée par du Bellay que le tout jeune Albert avait découvert, ébloui, dans la classe de 3è de Georges Sallet, son jeune professeur de français du lycée Gautier.

Albert Bensoussan, revenu en 1982 sur les terres algéroises, se sentira inconsolable orphelin de sa ville d’enfance, n’y retrouvant plus, même, la sépulture de ses ancêtres dans le cimetière juif d’Alger, ruiné par l’indifférence et le temps. « Nous fûmes indigènes sur cette terre algérienne qui, à l’Indépendance, nous fut refusée, mais nos traditions judéo-arabes, nos goûts berbères, la musique, la cuisine et les you-you, personne ne pourra m’en déposséder. […] Rien ne résiste au temps…sauf la mémoire ».
Ce livre, porté par la poésie infinie du souvenir et la tendre et profonde nostalgie d’un paradis perdu, est tout simplement magnifique.
L’Anneau d’Albert Bensoussan, Éditions Al Manar. 2017. 113 pages. ISBN 978-2-36426-082-5, prix: 20 euros.











